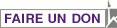« Les mystères du cerveau » - Échos d’un colloque
Les Cahiers Pédagogiques
jeudi 18 février 2010
Par Christine Vallin
La coordonnatrice du dossier « Aider à mémoriser » (n° 474) a assisté à une manifestation bien dans le prolongement de ce numéro.
Le 6 décembre 2009 a eu lieu un colloque organisé par l’université de Jérusalem et l’AFIRNe (Association franco-israélienne pour la Recherche en Neurosciences). Son thème, « Les mystères du cerveau », ne pouvait laisser les Cahiers pédagogiques indifférents. En effet, de nombreux dossiers se retrouvent en lien avec la préoccupation de mieux savoir comment fonctionne le cerveau, comment il apprend, pour quelles raisons au contraire l’apprentissage dysfonctionne ou comment on mémorise par exemple. C’est pour cette raison qu’il est souvent fait appel à des spécialistes pour des contributions.
Ce colloque a confirmé si besoin était tout l’intérêt de ces recherches. D’éminents spécialistes se sont succédé pour présenter certaines des découvertes les plus récentes en matière de régénération du cerveau adulte, ou du sommeil par exemple. Deux interventions se sont révélées particulièrement pertinentes pour la pédagogie. La première, « Comment le cerveau apprend : des synapses à la cognition » par Idan Segev, permettait d’entrer plus avant dans les mécanismes de liaison entre les dix milliards de neurones présents dans notre cerveau. L’information passe d’un neurone à l’autre en émettant des signaux électriques infimes (0,1 volt). S’établissent et se renforcent ainsi des connexions synaptiques. Ce qui frappe et ne peut qu’intéresser la pédagogie, c’est la plasticité du cerveau. L’apprentissage en effet permet d’installer des circuits neuronaux qui seront renforcés par la répétition. On pourrait donc dire que le fonctionnement du cerveau plaide à la fois pour la stimulation par le nouveau et ainsi créer des voies d’apprentissage, et plaide pour la répétition afin d’installer, stabiliser ces voies qui seront réactivables lors d’apprentissages ou d’actions ultérieures.
Une deuxième intervention retenait également l’attention : elle montrait par l’imagerie comment le cerveau lit. Laurent Cohen avec brio et clarté a exposé ce miracle de la lecture qui évoque, provoque. Et le fait que soudain il arrive que des patients ne sachent plus lire... Cela signifie qu’un système de lecture existe, qu’on n’est pas venu au monde avec, ce n’est pas la sélection, ni l’évolution darwinienne qui sont en cause.
L’imagerie montre qu’en arrière dans le cerveau se situe le cerveau visuel qui sert à reconnaitre les objets. Puis vers l’avant, la zone du langage servant à la prononciation et donnant accès à la signification. Grâce à ces zones, on reconnait les lettres de manière invariante, vertes, grandes... comme on reconnaitrait une chaise, qu’elle soit jaune ou petite. Vient ensuite la signification d’un mot. Des techniques d’imagerie mettent en valeur les connexions impliquées après la reconnaissance des lettres : soit on récupère dans sa mémoire tout ce que l’on savait à propos de ce mot et comment il se prononce (ex. : nuage) ; soit on retrouve seulement comment on le prononce (ex. : chabouda).
Ces principes de base rappellent combien certains invariants peuvent être utiles et qu’enseigner s’expérimente à partir de connaissances reçues en formation.